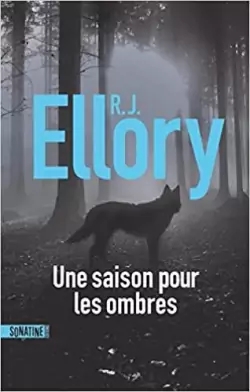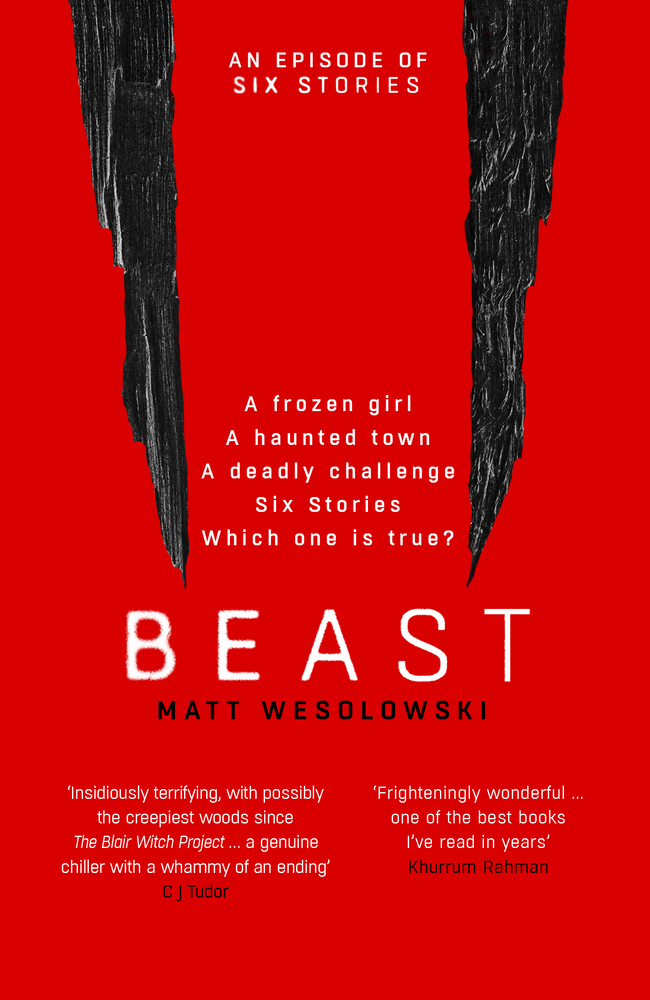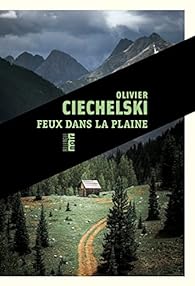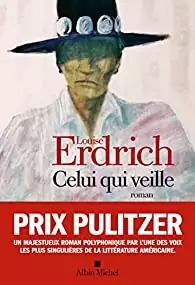« Quand on était noir au pays de la liberté, la moindre interaction avec un représentant des forces de l’ordre avait quelque chose de terrifiant. On avait l’impression de marcher en permanence le long d’un dangereux précipice. Et si en plus on avait le malheur d’avoir un casier judiciaire, c’était comme si ce précipice était bordé de peaux de banane. »
Ike Randolph et Buddy Lee Jenkins vivent tous deux en Virginie occidentale, mais pourtant dans des mondes séparés, l’un étant noir, ex-membre d’un gang, mais revenu dans le droit chemin pour sa famille, et l’autre, blanc, sorti de prison aussi, alcoolique vivotant d’expédients dans un mobil home délabré.
Ce qui aurait pu les rapprocher, ce sont leurs fils, Isiah et Derek, qui s’aiment, se marient, et ont même une petite fille. Mais aucun des deux pères n’accepte l’homosexualité de son fils, et c’est bien trop tard, lorsque les deux seront tués par balle dans une rue de Richmond, qu’ils regretteront de ne pas avoir su les écouter ou leur parler. Dès lors, l’idée de vengeance germe chez l’un, puis chez l’autre, d’autant plus que la police n’a aucune piste pour enquêter sur ce meurtre…
« On a tendance à voir la vengeance comme quelque chose de noble, de légitime, mais en vérité, c’est juste de la haine déguisée. »
La colère qui les éperonne va occasionner des scènes de brutalité un peu trop nombreuses. Ce roman n’est pas un polar, la police en est presque absente et même peu souhaitée entre les pages, il s’agit plutôt d’un roman noir où l’enquête est menée par les deux ex-taulards, ce qui n’est pas invraisemblable… On y croit vraiment.
Les deux personnages donnent du piquant au roman, notamment Buddy Lee qui ne manque pas d’un humour pas toujours partagé par son « collègue ». Par contre, l’auteur, lui, a le goût de la métaphore bien sentie, et ne manque jamais de faire des portraits bien croquignolets des personnages croisés : « Le premier golgoth était doté d’une moustache noire si épaisse qu’on aurait dit qu’un chat avait élu domicile sur sa lèvre. Quant au second, il avait un strabisme qui devait lui permettre de vérifier les priorités à droite sans tourner la tête. »
L’évolution des deux pères, d’homophobes « de base » à plus de compréhension pour les différences, n’est pas mal vue, et donne de la profondeur à ce roman où l’action, pour ne pas dire la violence, n’est jamais loin. L’ensemble n’est peut-être pas follement original pour qui a déjà lu pas mal de romans noirs américains, mais si j’ai l’air de faire la fine bouche, comme ça, je ne me suis pas ennuyée un instant, et j’ai déjà en ligne de mire les deux autres romans de l’auteur !
La colère de S.A. Cosby (Razorblade tears, 2021) éditions Sonatine, 2023, traduction de Pierre Szczeciner, 368 pages, sorti en Pocket.
Athalie en ressort un peu lassée par les scènes d’action, Dasola le conseille absolument et c’est une réussite pour Nicole.
Aurais-je raté d’autres avis ?