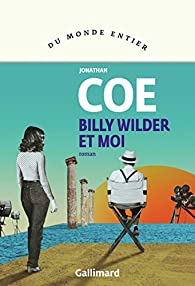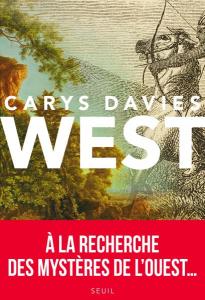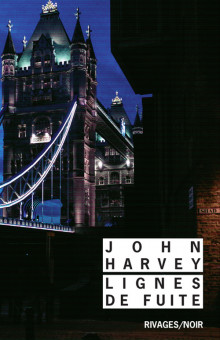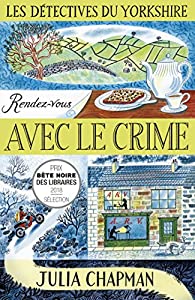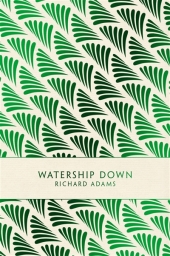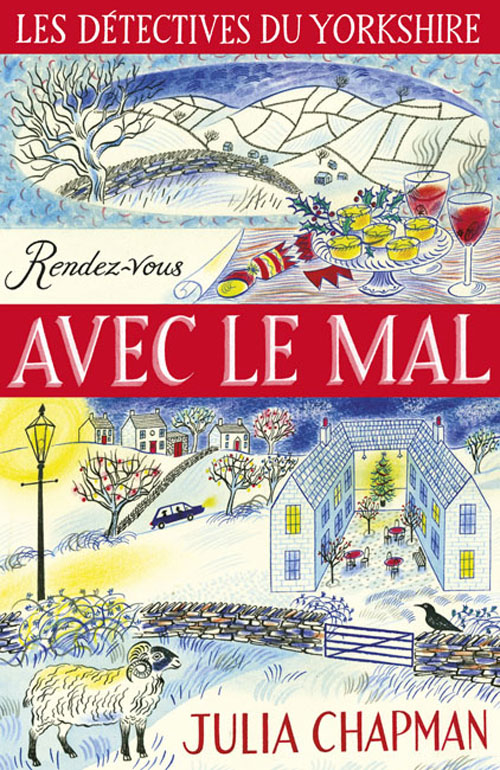
« Dans l’angle de la pièce, le chien s’étira, bâilla, se redressa sur ses pattes et daigna la rejoindre. En tant qu’agent infiltré, Calimero se la jouait flegmatique. »
Un petit plaisir du mois anglais est de retrouver des romans policiers, genre où les anglais excellent, avec une grande variété de sous-genres, pour tous les goûts et toutes les humeurs. J’ai donc choisi un « cosy mystery » d’une série que j’avais commencée l’année dernière. Intitulée « Les détectives du Yorkshire », elle ne comporte pourtant qu’un détective en titre, Samson, policier qui s’est fait oublier en quittant Londres pour le bourg de son enfance et en y ouvrant une agence de recherches. Mais voilà, Delilah, sa colocataire de bureau, et aussi amie d’enfance, qui elle, officie dans une agence matrimoniale, s’incruste quelque peu dans ses enquêtes, et même son chien s’y invite gentiment ! Il s’agit dans ce volume, en pleine période de Noël, d’accidents suspects à la maison de retraite. Quelqu’un voudrait-il s’en prendre aux résidents, parmi lesquels le père de Samson ?
« Il avait aussi entendu les récriminations des résidents mal disposés envers les offcumdens, les gens qui n’étaient pas de la paroisse de Bruncliffe.
Joseph, qui venait d’Irlande, était accepté. Tout juste.
Ana, qui était originaire d’Europe de l’Est, n’avait et n’aurait jamais aucune chance de l’être.
Ce n’était pas qu’ils soient ouvertement chauvins. C’est juste qu’ils étaient moins tolérants avec les étrangers. Plus prompts à juger sévèrement leurs erreurs. »
Il faut une soixantaine de pages pour se mettre dans le bain, puis les choses s’accélèrent. Ce n’est pas parce qu’on se trouve dans un « cosy mystery » que les seules questions vont être de savoir qui va venir prendre le thé, ou bien où est passé l’animal de compagnie de la grand-mère du détective. Rien de tout ça, enfin, presque… il y a bien de nombreuses tasses de thé, de charmantes vieilles dames et un animal disparu, mais pas seulement. Les choses vont en s’accélérant, en se compliquant pour le détective qui manque parfois un peu de subtilité pour saisir comment prendre les habitants de Bruncliffe. L’humour ne manque pas, les réparties fusent, les péripéties se succèdent, la psychologie des personnages s’affine…
Je n’ai pas regretté mon choix, et me suis même un peu plus amusée que dans le premier roman. Ce serait parfait à lire en VO, cette série, tiens, ne serait-ce pas une bonne idée pour l’année prochaine ?
Les détectives du Yorkshire, tome 2 : Rendez-vous avec le mal (Date with malice, 2017), de Julia Chapman, éditions Robert Laffont, 2018, traduction de Dominique Haas, 408 pages.