« Fernando sentit Goa bien avant de la voir. Il prenait son quart de garde sur le pont. Les voiles blanches tendues se confondaient avec un ciel que les nuages passant devant la lune rendaient laiteux. C’était une de ces nuits grises où le vent porte la promesse d’une pluie qui se fait attendre, où la houle écume sans se faire trop violente. En émergeant de l’écoutille, Fernando pris sa respiration pour se gorger du vent salé. Mais c’est une odeur, mélange de terre chaude détrempée par l’averse et d’humus, qui l’assaillit. »
Entre 1616 et 1628, de Lisbonne à Goa, de San Salvador de Bahia à la côte landaise, sur terre, mais surtout sur les océans, trois destins se croisent dans ce grand roman de marine et d’aventures : Fernando, jeune portugais qui s’enrôle tout jeune dans l’armée des Indes avec son ami Simão et embarque pour Goa. De son côté, Marie rêve d’échapper aux marais du Médoc et à la pauvreté. Elle quitte sa famille pour Bordeaux, où elle fera la preuve de son fort caractère, et devra fuir encore. Quant à Diogo, les combats pour la conquête de San Salvador de Bahia font de ce jeune homme un orphelin. Il va avoir pour seul ami et soutien Ignacio, un Tupinamba toujours armé de son arc et de son casse-tête, mais plutôt pacifique, somme toute. Et tous deux finiront par prendre aussi la mer…
La conquête des océans, des terres qui les bordent et de leurs richesses, donne lieu à de nombreuses escarmouches et batailles entre Hollandais, Espagnols et Portugais, mais c’est encore contre les éléments que le combat est le plus rude.
La rencontre entre les trois personnages principaux n’intervient qu’au terme de nombreuses péripéties. Il y sera question de vengeance, d’amour et d’argent, de fraternité et de violence, le tout dressant le riche tableau du monde à cette époque.
« Le Santiago seul a échappé au naufrage avec l’aide des marins et habitants de Guetaria. Pour les autres, qui ont échoué plus au nord, les équipages ont presque tous été décimés. Par la furie de l’océan et par la sauvagerie des habitants de cette côte. Le São José a perdu presque tous ses hommes, noyés, brisés par les débris de l’épave mêlés aux vagues, assassinés à terre pour les maigres possessions qu’ils avaient pu sauver ou, au contraire, parce qu’ils n’avaient rien à offrir à ceux qui voulaient les dépouiller. »
Le roman, Yan Lespoux étant historien, repose sur des faits avérés comme la prise de San Salvador de Bahia aux Hollandais ou la perte spectaculaire de navires portugais dans le golfe de Gascogne. Plus remarquable que la documentation est encore la parfaite immersion dans le XVIIème siècle. Aucun détail ne semble anachronique, les paroles, les comportements, et les manières de penser de chaque personnage sonnent tout à fait juste.
Les protagonistes sont nombreux, beaucoup plus que les trois que j’ai cités, et il est assez amusant de remarquer que les vrais « sauvages » de ce roman sont les habitants de la côte du Médoc, pilleurs d’épaves qui n’hésitent pas à tuer pour quelques possessions des naufragés. Par comparaison, Ignacio le Tupinamba paraît beaucoup plus civilisé. Il semble que ce siècle se montre plus favorable aux voleurs, aux menteurs, aux fripouilles qu’aux honnêtes gens, ou à ceux qui comptent essentiellement sur la chance. Seule la peur de la justice divine, et de l’Inquisition, maintient un semblant d’ordre.
En dépit de quelques descriptions un peu répétitives des lacs, dunes et forêts landaises, le style est plaisant à lire, solide mais sans effets inutiles. J’ai beaucoup aimé le réalisme des traversées à bord des caraques, ces gros navires marchands aussi trapus que patauds lorsque la mer est forte. Les marins, marchands et soldats à bord de la flotte menée par dom Manuel de Meneses de retour vers Lisbonne, en feront les frais.
Nul besoin d’avoir le pied marin pour aimer ce roman historique prenant dont le très beau titre est emprunté au poète Antonio Vieira :
« Un lopin de terre pour naitre ; la Terre entière pour mourir.
Pour naitre, le Portugal ; pour mourir, le monde. »
Pour mourir, le monde de Yan Lespoux, éditions Agullo, août 2023, 432 pages.
Déjà dévoré par Fanja, Ingannmic, Je lis, je blogue et Keisha, entre autres !
Nous continuons de suivre le Book trip en mer de Fanja.




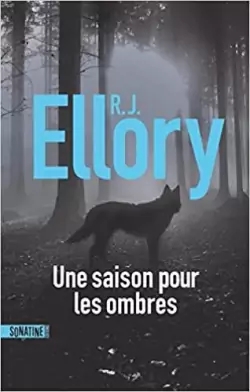

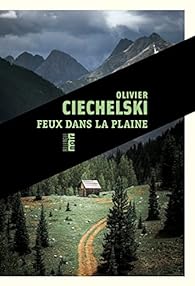
















 emblématique, de Sharbat Gula, une jeune afghane de 13 ans qui était alors réfugiée, dans un camp. Depuis il a parcouru le monde pour l’Agence Magnum, couvrant de nombreux conflits, a publié plusieurs livres et obtenu des prix prestigieux.
emblématique, de Sharbat Gula, une jeune afghane de 13 ans qui était alors réfugiée, dans un camp. Depuis il a parcouru le monde pour l’Agence Magnum, couvrant de nombreux conflits, a publié plusieurs livres et obtenu des prix prestigieux.













