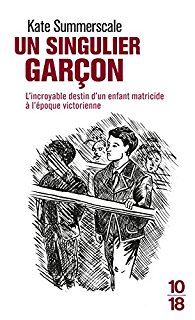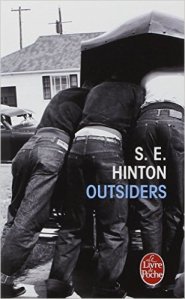« Quand Rosa et moi étions neuves, on nous avait placées au milieu de la boutique, à côté de la table des magazines, ce qui nous permettait de voir la moitié de la vitrine. Et donc d’observer la rue – les employés de bureau au pas pressé, les taxis, les coureurs, les touristes, l’Homme Mendiant et son chien… »
La narratrice, Klara, une AA, amie artificielle, comme on l’apprend dès les premières pages du roman, attend dans une boutique d’être choisie par un adolescent et de découvrir enfin le monde. Elle essaye de tirer des enseignements de ce qu’elle voit dans la rue, et s’intéresse plus que tout aux sentiments des humains, ce qui la distingue des autres robots présents dans le magasin. Lorsqu’elle échange un regard et quelques mots avec Josie, une adolescente de treize, elle n’imagine plus accompagner un autre enfant. Lorsque finalement, elle rejoint son nouveau domicile, elle observe beaucoup, comprend que Josie souffre d’une maladie, apprend à connaître la famille et l’entourage de la jeune fille. Elle imagine réussir à guérir Josie, par un expédient auquel personne n’a songé.
« Je suis surprise qu’une personne souhaite avec autant de vigueur suivre une voie qui la plongera dans la solitude.
– Et c’est ce qui vous surprend ?
– Oui. Jusqu’à ces derniers temps, je ne pensais pas que les humains pouvaient choisir la solitude. Que le désir de ne pas être seul pouvait être balayé par une force plus puissante.
Miss Helen sourit. » Vous êtes vraiment mignonne. Vous ne parlez pas beaucoup, mais je vois que vous réfléchissez. L’amour d’une mère pour son fils. Un sentiment si noble, pour surmonter la peur de la solitude. »
L’idée intéressante est d’avoir confié la narration à Klara, sa sensibilité, sa naïveté et sa manière de voir, au sens propre comme au figuré, conférant un ton particulier au roman. Le revers de la médaille, c’est que certains aspects de la société où elle évolue ne sont pas expliqués. Par exemple, pourquoi est-ce que ce sont les adolescents qui ont besoin d’amis artificiels, pourquoi certains enfants sont-ils « relevés » et d’autres non, qu’en est-il des opposants à ce système ? Les questions ne sont pas posées car Klara ne se les pose pas, mais certains points s’éclaircissent pour le lecteur grâce à des remarques entendues ici ou là par le robot.
Au final, un roman intelligent et touchant, par le biais de Klara, qui apparaît douée de sentiments pour lesquels elle n’avait pas été programmée.
Klara et le soleil, (Klara and the Sun, 2021), éditions Gallimard, août 2021, traduction de Anne Rabinovich, 384 pages.
Kazuo Ishiguro sur le blog : Lumière pâle sur les collines Les vestiges du jour Le géant enfoui
Les billets du Bouquineur, de Sibylline, d’Une Comète.