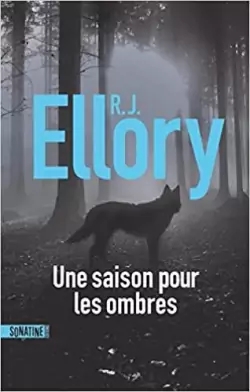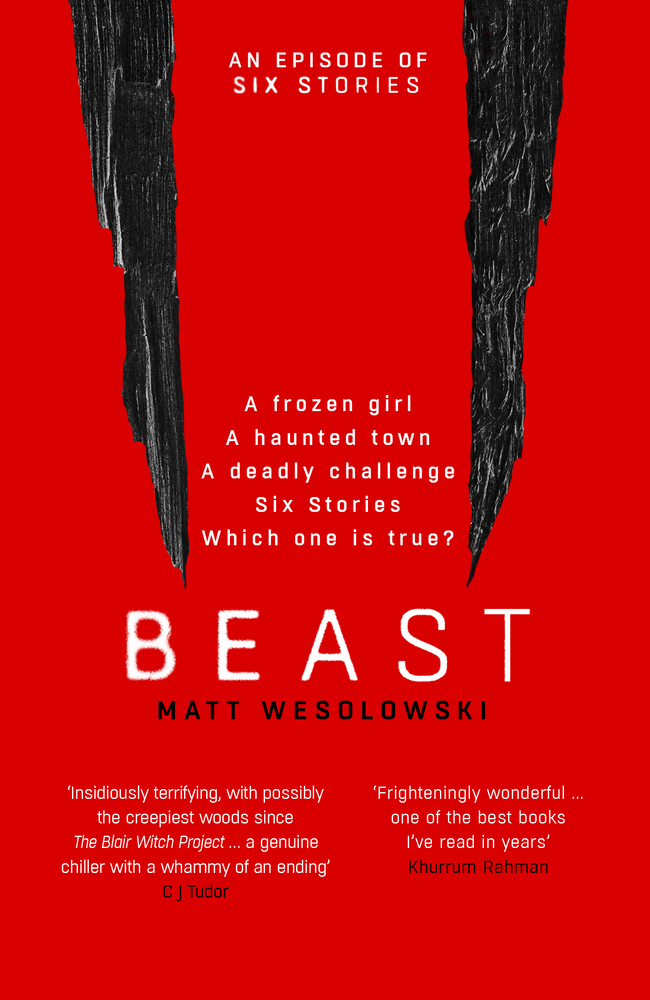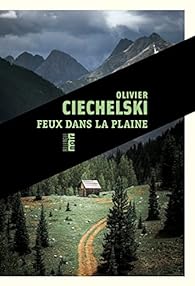A l’approche des Quais du Polar lyonnais, une petite cure de romans noirs et polars s’impose. Voici donc mes lectures « de genre » de février et mars, avec des succès divers. J’en ai lu deux en version originale, mais ne passez pas votre chemin, car ils sont déjà traduits en français !
Peter Heller, Le guide, Actes Sud, 2023, traduction de Céline Leroy, 304 pages.
Commençons par un auteur dont j’affectionne l’écriture depuis la lecture de La constellation du chien. Ce fut, comme toujours, un plaisir de le retrouver dans une histoire policière assez mouvementée. Jack, déjà rencontré dans La rivière, a trouvé un job de guide de pêche pour quelques célébrités qui viennent se ressourcer dans un coin perdu du Colorado. Mais Jack se rend vite compte de détails bizarres, que ce soit dans le comportement du personnel ou dans l’aménagement des lieux. Même s’il déprime quelque peu, sa curiosité n’est pas totalement éteinte ! Beaucoup de thèmes se mêlent dans ce roman qui joue bien son rôle (de page-turner) sans être le meilleur cru de l’auteur.
R.J. Ellory, Une saison pour les ombres, Sonatine, 2023, traduction d’Étienne Gomez, 408 pages.
Par une écriture immédiatement envoûtante, R. J. Ellory emmène les lecteurs dans le Nord du Canada, où des jeunes filles, sur plusieurs décennies, sont retrouvées mortes. Tout à leur peine, les familles acceptent la thèse d’une bête sauvage qui fait des ravages près des habitations. Seul Jack Devereaux, un enquêteur dans les assurances, revenu au pays, se pose des questions, d’autant plus que son propre frère se trouve parmi les suspects. Malgré ses qualités, notamment une superbe atmosphère, et des personnages complexes, ce roman comporte quelques longueurs et, à mon avis, ne révolutionne pas le genre.
Matt Wesolowski, The Beast (Le vampire d’Ergarth), Les Arènes, février 2024, 338 pages.
Encore une ambiance hivernale pour ce quatrième roman de la série « Six versions » où Scott King, réalisateur de podcast, revient sur de vieilles enquêtes au travers du portrait de six personnages touchant de prèe ou de loin à l’affaire. Ici, il s’agit d’une jeune fille, trouvée morte de froid dans une tour, à l’orée du village où elle vivait, et était (très) connue comme créatrice de contenu sur Youtube. J’ai été prise par cette plongée très bien orchestrée dans les méandres d’un cold case, qui s’attaque aux thèmes de l’image, de la notoriété, de la jalousie, dans le domaine des réseaux sociaux.
Olivier Ciechelski, Feux dans la plaine, Le Rouergue, 2023, 199 pages.
Stanislas Kosinski vit dans une maison isolée, entourée de forêts et de garrigue, où il fréquente le moins d’humains possible et s’absorbe dans des travaux physiques pour éviter de ressasser son expérience traumatisante de militaire au Mali. Deux événements vont venir troubler sa tranquillité, l’installation d’une bergère sur un terrain limitrophe, et l’incursion de chasseurs qui tracent un chemin pour couper à travers ses terres. Dès lors, tout va déraper.
Si j’ai bien accroché au début du roman, le tournant pris ensuite, avec des incompréhensions totales entre les habitants du cru, même le maire, et Stan, m’a laissée plutôt indifférente et pressée d’en finir. L’écriture parvient presque à redresser la barre, et à faire croire à cette histoire, presque seulement.
Abir Mukherjee, Death in the east (Le soleil rouge de l’Assam), Folio, 2024, 480 pages.
Le quatrième volume des enquêtes de Sam Wyndham et son adjoint Banerjee se démarque des précédents par sa forme, qui alterne deux périodes et deux lieux, 1905 à Londres, avec le meurtre d’une jeune femme que Sam connaissait bien, et 1922, où il soigne sa dépendance à l’opium dans un ashram dans la région verdoyante de l’Assam. Des thèmes comme la montée du nationalisme indien, et le racisme, donnent beaucoup d’intérêt au roman, et le style de l’auteur entre toujours pour une bonne part dans le plaisir de lecture, ses comparaisons et formules humoristiques ne manquant pas d’alléger l’atmosphère.
Bien qu’un peu moins convaincant, au départ, que les trois premiers, peut-être à cause de l’alternance passé/présent, ou des personnages, le roman rebondit aux trois-quarts du texte. Un événement inattendu lui donne alors un nouvel élan. D’ailleurs, je conseille de ne pas lire des critiques trop détaillées qui en font part… Un bon roman, finalement !
Avez-vous lu ou pensez-vous lire certains de ces romans ?