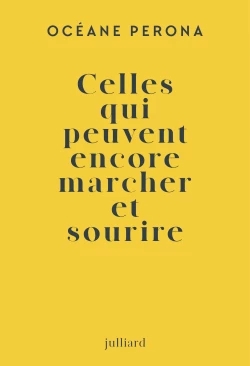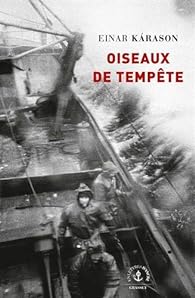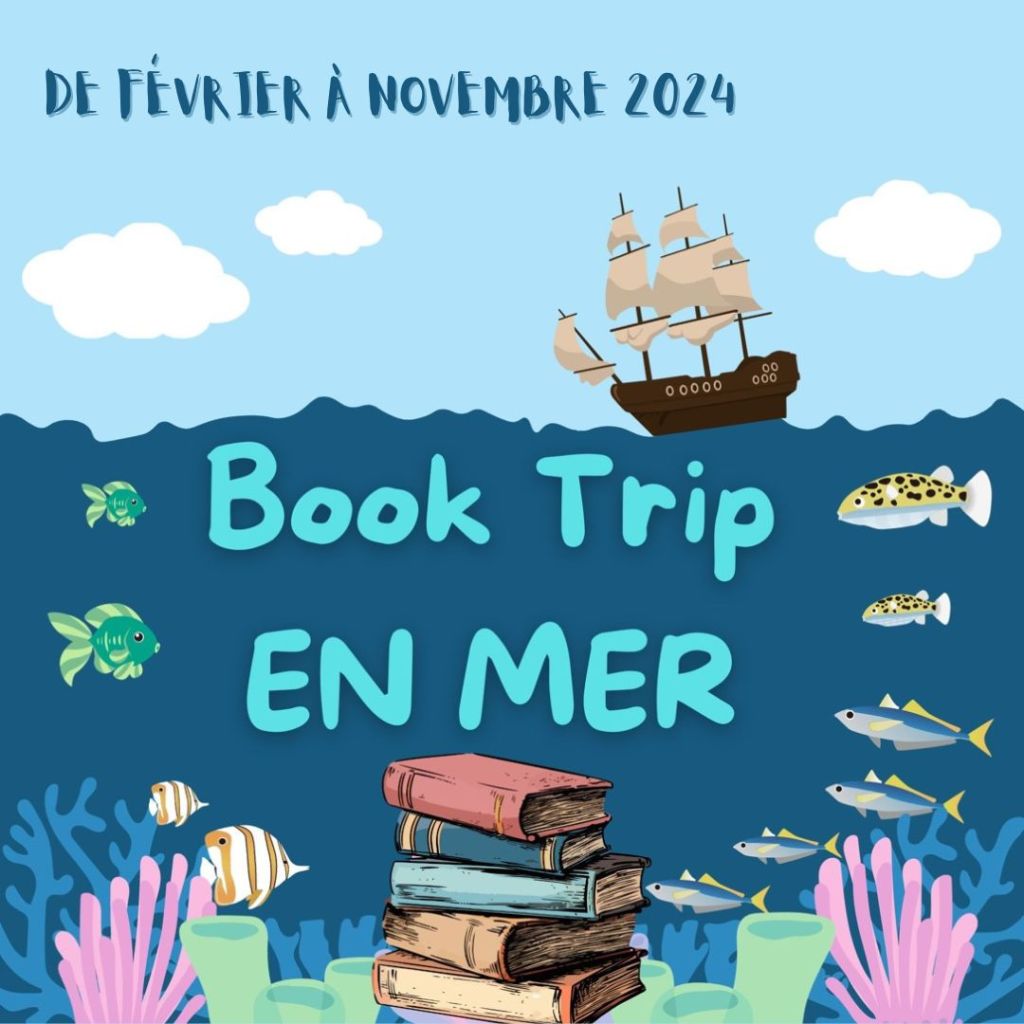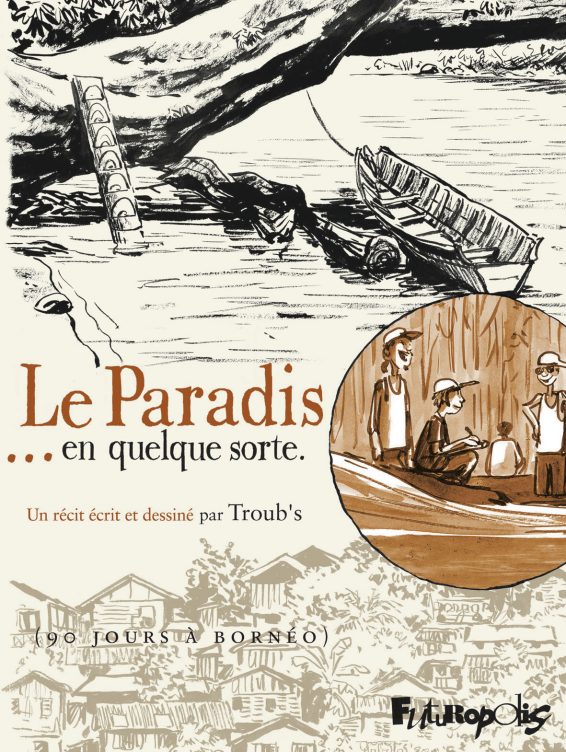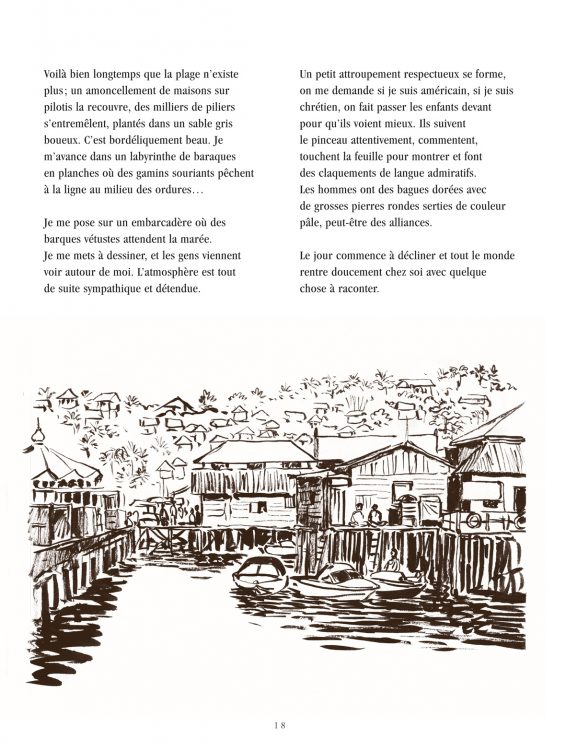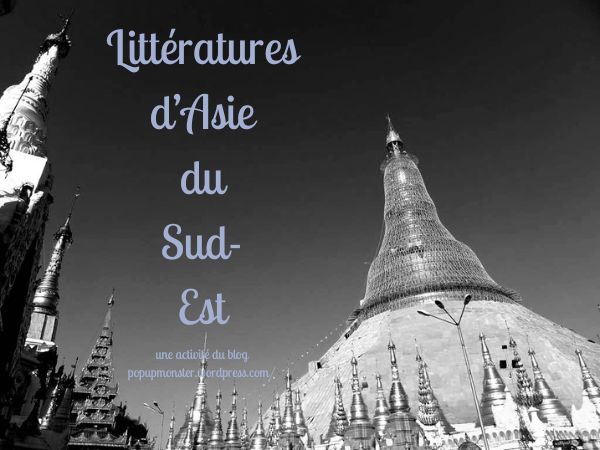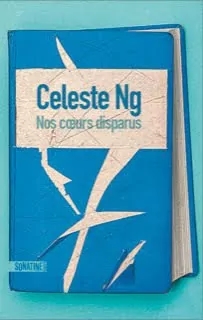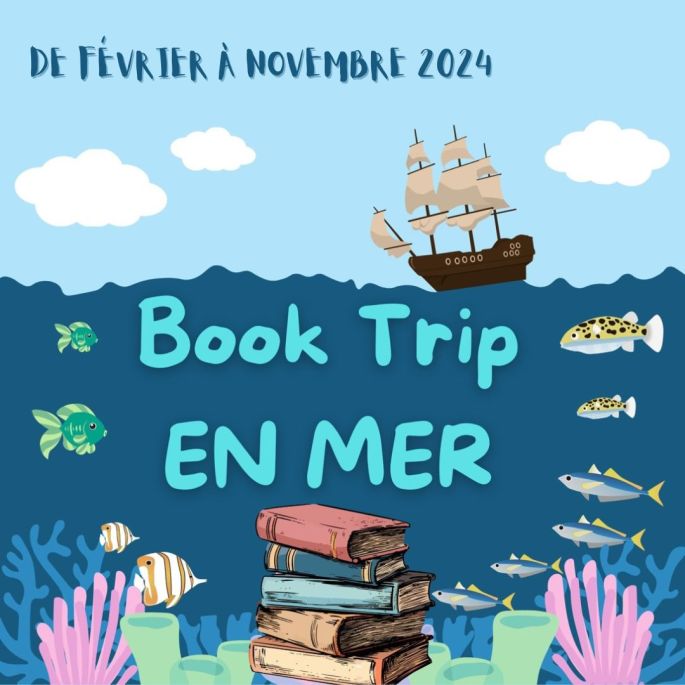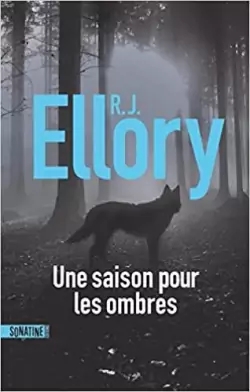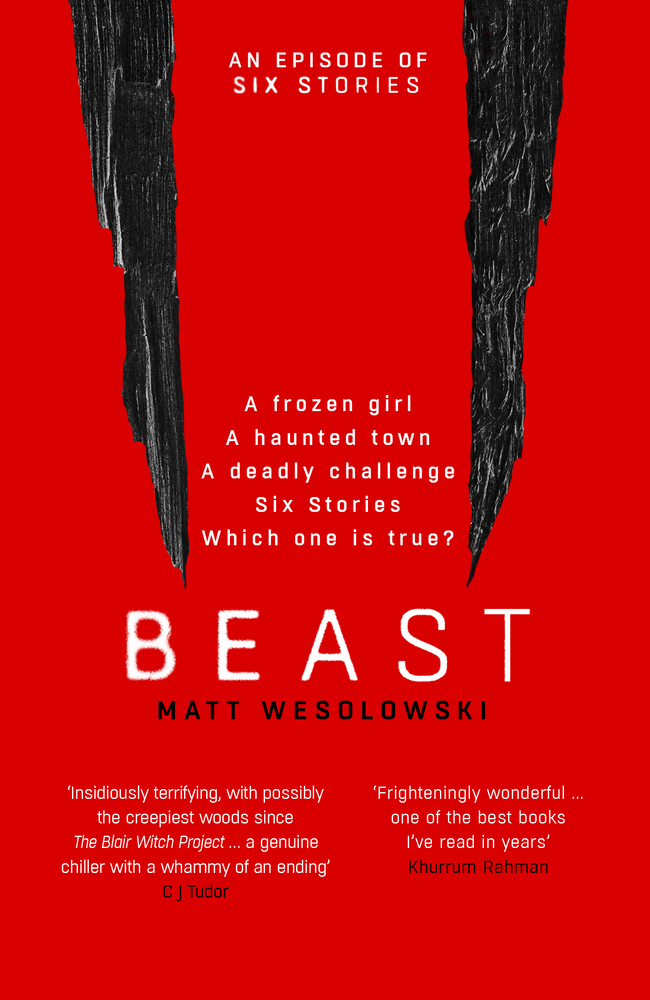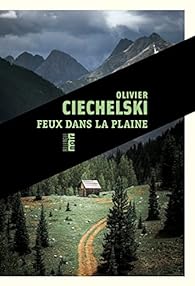« L’ambiguïté morale du journalisme n’est pas dans les écrits mais dans les relations humaines qui en sont à l’origine ; et ces relations humaines sont invariablement et inévitablement déséquilibrées. »
Dans cet essai, Janet Malcolm revient sur l’affaire Jeffrey McDonald, un homme accusé en 1970 d’avoir tué sa femme et ses deux petites filles. Tout d’abord blanchi par un tribunal militaire, il passe de nouveau devant un jury et risque cette fois une lourde condamnation. Pendant la préparation du procès, un journaliste et écrivain sans succès nommé Joe McGinnis se présente à lui, lui affirme qu’il le croit innocent et lui propose d’écrire un livre sur l’affaire, ce qui pourrait aider à sa défense. Il a accès à tous les documents des avocats, se rapproche de l’accusé au point que les deux hommes deviennent amis, et se confient l’un à l’autre. Lorsque McDonald est condamné par le jury, le journaliste continue à correspondre avec lui, à lui promettre la parution prochaine du livre. Et là, on se dit que le livre ne paraîtra jamais, mais si ! Seulement, il présente McDonald comme un psychopathe égocentrique, tout à fait capable de tuer sa famille…
« Nous avons l’impression que quelque chose se produit dans la tête des gens quand ils rencontrent un journaliste, et que c’est en réalité exactement le contraire de ce à quoi on s’attend. On pourrait penser qu’une méfiance et une prudence extrêmes seraient à l’ordre du jour, mais en réalité, impétuosité, impulsivité et confiance puérile sont bien plus fréquentes. »
J’ai cru pendant un moment, avant d’avoir ouvert le livre, que son titre était La journaliste et l’assassin, la journaliste étant Janet Malcolm… Elle est bien journaliste aussi et le sujet qu’elle traite est passionnant. Il s’agit d’un essai brillant qui étudie, à fond et avec autant d’impartialité que possible le thème des relations entre un journaliste ou un auteur, et la personne dont il dresse le portrait, en partant de ce cas, mais en en évoquant d’autres aussi.
Est-il honnête de faire croire qu’on partage les idées de quelqu’un, de devenir son ami, pour ensuite en dresser un portrait à charge ? Y a-t-il des limites à ne pas franchir, des règles déontologiques à respecter ? Janet Malcolm le pense, et l’écrit.
En tout cas, après lecture de Fatal vision (quel titre!) sur « son » affaire, McDonald a porté plainte contre le journaliste qui avait abusé de son amitié, et, grâce à un excellent avocat, le jury est allé dans son sens.
C’est intelligent, pas rébarbatif pour deux sous, et illustré par cette affaire hors norme, cela rend le livre encore plus passionnant. Il ne faut simplement pas y chercher de nouvelles pistes pour la première affaire, l’affaire criminelle, qui continuera de partager les commentateurs. Si le sujet vous parle, voici une réédition dans une nouvelle collection de poche qui mérite votre intérêt !
Le journaliste et l’assassin, (The journalist and the murderer, 1990) de Janet Malcolm, éditions du Sous-Sol, janvier 2024, traduction de Lazare Bitoun, préface d’Emmanuel Carrère, 240 pages.