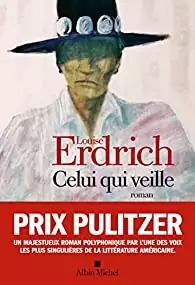« Dix ans de réclusion, voilà le prix de sa liberté selon les Blancs. Pour les Innus, c’est le bannissement à vie de sa communauté. Une sentence définitive. Jugé coupable du meurtre de son père, il ne pourra jamais retourner chez lui. »
Tiohtia:ke, (à prononcer « Djiodjiagué ») c’est le nom de Montréal pour les mohawks. C’est là que Élie Mestenapeo descend du train pour commencer une nouvelle vie. Après dix ans de prison pour parricide, il ne peut pas rejoindre sa communauté innu de la Côte-Nord, dont il est banni à vie. Cette double condamnation est dure pour le jeune homme, mais il l’accepte. La ville, et le visage complètement inconnu qu’elle lui offre, en font une proie facile, mais heureusement il rencontre rapidement Geronimo, qui lui vient en aide, puis d’autres exclus, issus comme lui de différentes nations autochtones.
« L’air du square Cabot ne dégage aucune senteur. Pourtant, le vent l’a porté sur des milliers de kilomètres à travers Nitassinan. Il a traversé des forêts et des centaines de lacs et de rivières, mais il n’en a rien gardé. Comme si le béton de la ville en aspirait toute vie pour n’en laisser que ces bourrasques glacées qui sentent l’absence. »
De Michel Jean, j’ai déjà lu Kukum, un beau roman plein de sobriété inspiré de la vie de l’arrière-grand-mère de l’auteur. J’ai retrouvé avec plaisir son empathie pour tous, ici pour les nombreux habitants du square Cabot, anonymes aux yeux de beaucoup, devenus de belles personnalités sous sa plume.
L’entraide existant entre les sans-abris est mise en avant par Michel Jean, plutôt que les agressions et les vols, même s’il n’occulte pas les difficultés, le froid, la faim, le manque de toutes les commodités les plus élémentaires. On pourrait lui reprocher d’embellir un peu les bons côtés, d’accorder à Élie quelques circonstances favorables. Personnellement, je ne me plains pas de ce bon tempérament de l’auteur qui lui fait éviter d’écrire des romans trop sombres sur des sujets déjà difficiles. Il n’occulte pas les drames, il les laisse un peu à la marge, il ne s’appesantit pas.
L’émotion n’est pas absente pour autant, au contraire, la grâce et la concision de l’écriture rendent le roman de plus en plus émouvant au fil des pages. Si vous avez aimé Kukum ou d’autres romans de Michel Jean, le parcours d’Élie et de ses compagnons du square Cabot ne devrait pas vous décevoir.
Tiohtia:ke [Montréal] de Michel Jean, le Seuil, septembre 2023, 192 pages.
Les avis de Karine, de Hélène (Lecturissime) et de Luocine aujourd’hui même !