Vu mon retard de rédaction de chroniques, je retrouve la bonne vieille méthode qui consiste à regrouper en un seul billet mes lectures, fastes ou non.
Margaret Kennedy, Le festin (The Feast, 1950) éditions La Table Ronde, 2022, traduction de Denise Van Moppès, 480 pages.
« Chacun s’était retiré, comme un animal se retire au fond de sa cage avec son os, pour ronger quelque idée fixe. Et cela lui faisait peur. Elle ne pouvait plus supporter d’être enfermée dans ce sombre repaire de bêtes étranges. Elle eut envie de sortir, de quitter l’hôtel, d’aller se réfugier sur les falaises. Elle se leva et quitta la pièce. Personne ne remarqua son départ. »
On a beaucoup vu cette réédition ces derniers mois. Margaret Kennedy a écrit en 1950 ce roman qui décrit un microcosme des plus anglais pendant quelques semaines. Plusieurs groupes de personnes se trouvent dans une pension de famille sur la côte de Cornouailles lorsqu’un pan de falaise se détache et fait un certain nombre de victimes. Cela est connu dès le début, et un retour en arrière va permettre de connaître tout ce petit monde. Tout de suite c’est l’humour anglais qui marque mais le nombre de personnages et les changements constants de narrateur déconcertent un peu. Finalement, l’humour est de moins en moins appuyé au fur et à mesure des pages, et j’ai trouvé cela dommage. J’ai été également incommodée par quelques discussions longuettes.
Une lecture agréable, finalement, mais pas inoubliable.
Luc Blanvillain, Le répondeur, éditions Quidam, 2020, 260 pages.
« Doublure vocale. Pas plus indigne que de nettoyer des bureaux ou de mener des enquêtes de satisfaction. Il avait fait les deux. Et bien d’autres choses épuisantes, matinales ou nocturnes, dominicales, répétitives. Au moins, il pouvait rester chez lui, perfectionner son répertoire et bosser au lit. Sans compter qu’endosser provisoirement la vie d’un glorieux quinquagénaire, à son âge, n’était pas donné à tout le monde. »
Baptiste tente de gagner sa vie en tant qu’imitateur. Assez doué, il réussit bien certaines voix, sans pour autant aller plus loin que les petites salles à moitié vides.
Jusqu’au jour où un auteur réputé lui propose de devenir son employeur. Si Baptiste l’imite en répondant à toutes ses sollicitations téléphoniques, Pierre Chozène aura ainsi le temps et l’esprit libre pour écrire. Il met Baptiste au courant des habitudes de chacun de ses interlocuteurs et lui confie son portable…
Habile comédie, ce roman distrait mais ne manque pas de profondeur en abordant les rapports familiaux et amoureux, et en poussant au bout la jolie idée de départ.
Je ne connaissais pas cet auteur, j’ai été emportée par cette histoire qui ne manque pas de sel.
Paco Ignacio Taibo II, Cosa facil, éditions Rivages, 1994, traduction de René Solis, 244 pages.
« — Vous n’avez jamais songé que la différence entre le Moyen Âge et la ville capitaliste consiste foncièrement dans le réseau d’égouts ?
Hector fit signe de la tête que non.
— Vous ne vous rendez pas compte que la merde pourrait nous arriver jusqu’aux oreilles s’il n’y avait pas quelqu’un pour s’en occuper ? »
Deuxième lecture de Paco Ignacio Taibo II, après Jours de combat qui m’avait enchantée. Dès les premières pages, Hector Belascoaran Shayne, pourtant le contraire d’un joyeux luron, m’a mis le sourire aux lèvres : les citations en tête de chapitres, le style inimitable, le côté improbable des enquêtes dans lesquelles Hector se lançait tête la première, tout fonctionnait encore comme dans le premier volume.
Mais petit à petit, j’ai trouvé les enquêtes de ce détective atypique tellement ténues, les personnages même manquant de chair, que je retournais à reculons vers le roman. Non, décidément, ça ne me passionnait plus…
Avis très mitigé donc, et je ne pense pas poursuivre la série.
John A. McLaughlin, Dans la gueule de l’ours, (Bearskin, 2018) éditions Rue de l’Echiquier, 2020, J’ai lu, 2021, traduction de Brice Mathieussent, 448 pages.
« La forêt était étrangement animée, une gigantesque bête verte en train de rêver, sa peau parcourue d’ondes frissonnantes.
Pas vraiment menaçante, mais puissante.
Attentive.
Il imagina un instant que la forêt était en colère, déçue, qu’il était personnellement responsable de cette intrusion des braconniers tueurs d’ours. »
Je ne sais plus quel avis enthousiaste m’a fait noter ce roman noir, n’hésitez pas à vous signaler. Recherché par un cartel mexicain, Rice Moore espère sauver sa vie en se cachant dans les Appalaches en tant que garde forestier. Mais l’endroit n’est pas des plus calmes non plus, d’autant que des braconniers y tuent des ours.
Il faut savoir tout de suite que ce roman est plutôt rude, que les âmes sensibles en soient conscientes. J’avoue avoir un peu chipoté au cours de ma lecture, l’auteur ou son personnage en faisaient un peu trop, et puis, de manière surprenante, ce roman m’a manqué pendant plusieurs jours après l’avoir fini, j’aurais aimé continuer encore ou retrouver ce coin des Appalaches et aucune autre lecture ne trouvait grâce à mes yeux.
Un roman qui bouscule et laisse des traces…
Luisa Carnés, Tea rooms : femmes ouvrières, 1934, éditions La Contre-Allée, 2021, traduction de Michelle Ortuno, 270 pages
« Ces délectables odeurs exquises des cuisines riches (…) nous rappelant que notre faim ne date pas de quelques heures ni de plusieurs années, qu’il s’agit d’une faim de toute une vie, ressentie depuis plusieurs générations d’ancêtres misérables. »
Dans les années 30 en Espagne, les femmes de milieux défavorisés ont le choix entre le mariage et les maternités qui s’enchaînent ou des métiers difficiles et peu valorisés. Matilde doit absolument subvenir aux besoins de sa famille, et trouve un emploi dans un salon de thé madrilène. Sous-payée et exploitée, elle observe cependant et commence à prendre conscience du carcan où elle se trouve enfermée.
Ce livre est curieux autant qu’il est intéressant. Tout d’abord l’écriture dénote d’une certaine modernité. Ensuite, le roman raconte aussi bien les petits cancans et menus faits qui se déroulent dans le salon de thé, qu’il se fait féministe et politique lorsqu’il s’agit des droits des employés.
Cela déroute un peu, mais en fait un objet littéraire inhabituel, à découvrir si vous en avez l’occasion…
Voilà pour ce mois de juin !
Avez-vous lu certains de ces romans ?





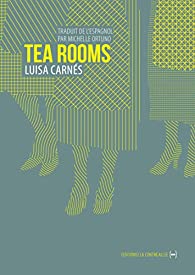
 « L’ambiance de la fête de baptême a changé quand Albert Cousins a fait son apparition avec du gin. »
« L’ambiance de la fête de baptême a changé quand Albert Cousins a fait son apparition avec du gin. »



