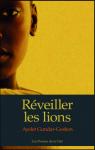« De grosses masses nuageuses d’un noir bleuté s’accumulent au-dessus de la prairie, et des éclairs fissurent l’horizon tandis que le vent agite ses cheveux. C’est dans ces moments-là que le monde a l’air le plus vivant, comme si elle n’était qu’un moustique sur la peau d’une grosse bête. »
Continuons le mois de la nouvelle avec ce recueil d’une jeune autrice américaine d’origine à la fois polonaise et bengali, ayant grandi à Pittsburgh. Ce livre a reçu le Chautauqua Prize et a été retenu en 2018 parmi plusieurs sélections des meilleurs livres de l’année.
Dans « Le monde, la nuit », pendant la Conquête de l’Ouest, une jeune femme albinos préfère vivre la nuit. Alors que son mari est parti au loin pour travailler, elle découvre une grotte où elle prend l’habitude de se réfugier. Cette nouvelle est-elle fantastique ou bien montre-t-elle la grande force de l’imagination, ça peut se discuter.
Dans « Poumons de verre » un père, lourdement handicapé par un accident industriel, se préoccupe de l’avenir et du bonheur de sa fille, ce qui va le mener bien loin, jusqu’en Egypte.
Dans « Logging Lake » un jeune homme va subir, subir est vraiment le mot exact, car le moins qu’on puisse dire est qu’il n’est pas partant, une parenthèse aventureuse avec son amie du moment, dans une vie bien calme.
« Tueur de rois » évoque le poète John Milton au soir de sa vie, aidé à écrire par une étrange comparse ailée. J’avoue que je ne connaissais pas trop Milton, ce qui ne m’a pas empêchée d’apprécier la nouvelle.
Dans « Tous les noms qu’ils donnaient à Dieu » deux jeunes femmes, enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria, découvrent au fil des années un étrange pouvoir qu’elles possèdent sur les hommes.
« Pendant ce temps-là, l’attention qu’il portait au reste du monde se relâcha, et ce n’est que lorsque la sirène plongea la tête sous l’eau qu’il constata que son embarcation avait dérivé et se trouvait à une trentaine de mètres de lui. »
« Robert Greenman et la sirène » est l’histoire d’une pêche miraculeuse et d’une belle créature marine, mais aussi celle d’une emprise.
Rien de fantastique dans « Tout ce que vous désirez » sauf peut-être dans l’esprit de Gina, jeune fille empêchée de vivre à sa guise par un père despotique, et qui cherche par quel moyen quitter sa petite ville du Montana.
« Les Pléiades » montre encore une fois la grande imagination d’Anjali Sachdeva. Elle met en scène ici des parents croyant farouchement à la Science, qui donnent naissance, par la magie de la génétique, à des septuplées, sept parfaites petites filles semblables. L’une d’entre elles raconte leur histoire, son histoire.
Je n’ai pas cité une nouvelle ? Ah oui, il s’agit de « Manus », un texte d’anticipation, où, dans un avenir plus ou moins proche, un peuple de Maîtres remplace des membres humains, comme les mains, par des prothèses plus fonctionnelles. C’est celle qui m’a le moins plu.
L’aspect fantastique n’est pas toujours marqué dans les textes, il est même parfois très discret. C’est la magie de l’écriture, très évocatrice, qui permet de se plonger rapidement dans des mondes dissemblables, et d’y croire immédiatement, malgré un soupçon d’étrangeté, et grâce à une psychologie des personnages très subtilement observée.
Je recommande ce livre aux fans de nouvelles, qui ne manqueront pas d’y trouver leur compte et d’élire leur préférée parmi ces textes originaux et captivants. Pour ma part, j’hésite entre Tous les noms qu’ils donnaient à Dieu et Robert Greenman et la sirène.
Tous les noms qu’ils donnaient à Dieu, d’Anjali Sachdeva, (All the names they used for God, 2018), éditions Albin Michel, Terres d’Amérique, 2021, traduit de l’anglais par Hélène Fournier, 288 pages.
Repéré grâce à Cathulu et Jostein.
Bonnes nouvelles, c’est en janvier chez Doudoumatous.