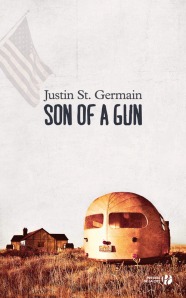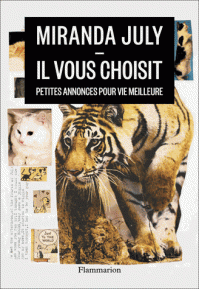« Je ne sais pas, dit Carl, songeur. À quoi servent les hommes, de nos jours ? »
« Je ne sais pas, dit Carl, songeur. À quoi servent les hommes, de nos jours ? »
Comme c’était précisément la question que Sully avait soigneusement évité de se poser toute sa vie, il jugea le moment bien choisi pour changer de sujet. »
Je me suis souvenue au bout de quelques chapitres de ce roman que j’avais noté tout d’abord de lire Un homme presque parfait, puisqu’il constitue un premier volet avec les mêmes personnages une ou deux décennies plus tôt. Malgré cette omission, j’ai énormément apprécié, cette fois encore, les personnages créés par Richard Russo, et ai lu le roman avec autant d’enthousiasme que lorsque javais découvert l’auteur dans Quatre saisons à Mohawk ou Le déclin de l’empire Whiting. Comme ses autres romans, si on excepte Le pont des soupirs qui se déroule à Venise, Richard Russo met en scène une petite ville de la côte Est des États-Unis, et ses habitants. Ici, il s’agit de Bath, une cité du New Jersey, toujours dans l’ombre de sa voisine et concurrente mieux lotie, Schuyler Springs. En effet, les mauvais coups du sort s’acharnent sur Bath, le cimetière y est victime d’écoulements inopportuns, une puanteur d’origine inconnue se répand sur la ville, un immeuble s’effondre…
« Raymer avait toujours été torturé par le doute ; à force de laisser les opinions que les autres avaient de lui prendre le dessus sur la sienne, il n’était jamais sûr d’en avoir une. Enfant, il avait été particulièrement sensible aux insultes, qui non seulement le blessaient profondément, mais le rendaient idiot. Vous le traitiez d’imbécile, il le devenait aussitôt. Vous le traitiez de peureux, il devenait froussard. Plus déprimant encore : l’âge adulte ne l’avait guère changé. »
Les habitants ne sont guère mieux lotis, et que ce soit le chef de la police Douglas Raymer, Sully et Rub, deux piliers de comptoir aux vies compliquées, Carl et ses projets aussi ambitieux que précaires, Charice l’adjointe de Douglas, ou son frère Jerome, tous vont de malheurs en déconvenues, de contrariétés en catastrophes. Et il faut bien avouer que certaines de ces mésaventures sont plus hilarantes que désolantes !
L’humour de Richard Russo se conjugue toujours d’une grande tendresse pour ses personnages, qu’il rend particulièrement vivants et sympathiques, malgré ou à cause de leurs déboires. Il traite avec empathie des relations familiales et amicales, explore les comportements violents ou délictueux, ausculte les effets de la pauvreté, n’oublie pas nos amis les animaux…
Les six cents et quelques pages de ce roman m’ont accompagnée lors d’une semaine de vacances, et ce fut un très grand plaisir de lecture !
À malin, malin et demi de Richard Russo (Everybody’s fool, 2016) éditions de la Table Ronde (août 2017) traduit par Jean Esch, 613 pages.
Voici l’avis de Jérôme, d’autres parmi vous l’ont-ils lu ?
Ce sera l’étape du New Jersey pour mon projet 50 états, 50 romans.


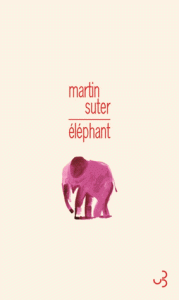










 Rentrée littéraire 2016
Rentrée littéraire 2016